Apprendre les hiéroglyphes égyptiens
Dictionnaire des hiéroglyphes Ancien Egyptien
Hieroglyphs dictionay of Ancient Egyptian
CHAP 2... La plastique grecque de l'époque géométrique à l'époque hellénistique
III] L'époque classique (Ve - IVe)
On distingue trois époques successives au niveau sculptural : Le style sévère (450-400), le premier classicisme (450-400), et le second classicisme (400-300).
A/ Le style sévère : 500-450
l se différencie notablement du
style archaïque. Le sourire archaïsant disparaît complètement, remplacé par une
attitude inexpressive des visages.
1)
Les origines
Pourquoi ce passage dans le visage ? On pense aujourd'hui que tout doit tourner
autour des guerres médiques (490-480). A ce moment là, après ces importantes guerres
et batailles, se développe chez les Grecs et à commencer par les Athéniens, un sentiment de supériorité
parce qu'ils ont vaincu l'immense empire perse. C'est donc un peuple qui n'est plus
vraiment du monde des mortels mais qui se rapproche des dieux. Ors, dans l'art, les dieux
étant les maîtres de tout, ne sont pas soumis à la sentimentalité et ne peuvent donc
l'exprimer. Les Grecs se veulent cette maîtrise.
Le style est très connu, mais mal représenté par le
manque d'œuvres originales. Un des plus célèbre est le bronze de Poséidon qui nous
est parvenu intact : à l'époque la statue fut enlevée par les romains, et le bateau a
coulé ! La main droite devait tenir un trident.
2) L'aurige
a. Aspects et historique
Un autre bronze, de la même époque, le fameux aurige. Il fait 1,80 mètres de
haut. Il fut découvert par des Français en 1896 dans le sanctuaire de Delphes. On sait aussi que cette statue
faisait partie d'un groupe sculptural plus imposant. Il s'agissait d'un aurige, sur son
char et tiré par quatre chevaux.
L'ensemble reconstitué voit l'aurige sur son char avec quatre chevaux
et, suivant les reconstitutions, un enfant et un cheval marchant devant ou deux enfants et
deux chevaux marchant de côté.
Malgré les destructions, on a réussi à conserver une partie de la
dédicace : elle fut consacrée par Polyzalos fils de Deinoménès. Il s'agit d'un tyran de la ville de Géla, en Sicile. Selon la tradition, il aurait consacré cette sculpture à Apollon pour le remercier de la victoire de
son attelage aux Jeux Pythiques
en 476 ou en 472 a.J-C.
Une autre théorie vise à expliquer la présence de chevaux isolés. En
effet si la victoire revenait au quadrige, pourquoi 5 ou 6 chevaux au total ? La victoire
ne serait alors pas celle de Polyzalos, mais celle de son frère Hiéron. Ce dernier est l'un des fameux
tyrans de Syracuse. On sait que
Hiéron a aussi fait courir des chevaux aux Jeux Pythiques, qu'il a emporté une victoire
au quadrige et deux victoires sur cheval isolé. Pourquoi Polyzalos consacre-t-il, lui, la statue alors ? Hiéron aurait commencé la
construction, serait mort, et l'achèvement aurait été le fait de Polyzalos.
b. Commentaire
Chose curieuse quand on observe
l'aurige : malgré la victoire, l'aurige est impassible ! Il porte la tunique de course
classique ; au niveau du buste et de l'épaule, le tissu est bouleversé par le mouvement
du vent. Par contre la partie inférieure est rigide, comme une colonne. C'est que dans
l'ensemble, la partie inférieure, est invisible, cachée par les chevaux ; il n'était
donc pas utile de la sculpter !
Sur le visage, il apparaît de prime abord fermé, sévère. Cependant, en
observant de près, on remarque un aspect subtil : en regardant le côté droit du visage,
la commissure des lèvres est légèrement relevée. Le personnage aurait ainsi un sourire
très fin, totalement maîtrisé.
3)
Les frontons du temple de Zeus à Olympie
Les œuvres les plus
caractéristiques du style sont les sculptures des deux frontons du temple de Zeus à
Olympie ; ce sont des sculptures d'école !
Ils ont été représentés vers 460
a.J-C et sont restés en place jusqu'au VIe siècle, détruits par un
tremblement de terre. Ces statues étaient peintes, avec les couleurs habituelles. On sait
également qu'elles étaient décorées d'éléments métalliques : des lances, des
couronnes, mais également les reines des chevaux etc. La décoration est donc très
riche, au-delà du marbre qui nous est parvenu.
a. Le fronton est
Il
représente un élément mythologique : une course de char opposant Oenomaos et Pélops. Selon la légende, Oenomaos avait une fille : Hippodamie. Son père
apprend par un oracle que si elle se marie, il mourra de la main de son gendre. Il invente
donc un stratagème : il a à sa disposition un attelage divin, des chevaux offerts par
son père Arès, dieu de la
guerre. Ces chevaux courent plus vite que tous les autres. Il met donc Hippodamie comme
prix à une course de chars. Treize prétendants se présentent et échouent. Celui qui
perd la course a pour gage la mort.
Arrive alors un quatorzième prétendant : Pélops. Il accepte le pari, mais lui aussi à des chevaux divins : ceux de
Poséidon ! Les données sont alors égales, seulement les chevaux étant divins tous deux
sont égaux en vitesse : il n'y aurait donc pas de vainqueur. Seulement dans sa grande
largesse, Oenomaos laissait partir les prétendants en avance. De fait, Oenomaos est
vaincu, marie sa fille et sera tué par Pélops.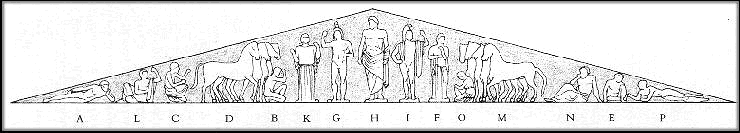
Sur le fronton, on est au départ de la course. Au centre, plus grand de
tous, probablement Zeus. A sa gauche et à sa droite deux guerriers, respectivement
Oenomaos et Pélops. Toujours dans un esprit symétrique, deux femmes : à droite Hippodamie, plus petite que l'autre femme,
les bras légèrement levées comme se passant un voile prénuptial sur la tête. A gauche
la femme d'Oenomaos, dans une position d'inquiétude. Puis les attelages avec les
palefreniers. Ensuite deux hommes barbus et assis, qu'on reconnaît comme des philosophes.
Ils appartiendraient aux deux familles parmi lesquels on tirait au sort les deux prêtres
du temple de Zeus. Enfin, aux extrémités, deux personnages couchés symbolisant les deux
fleuves de la région d'Olympie.
Les statues sont toutes isolées les unes des autres, étant
chacune un tout. Egalement, on distingue des lignes directrices rectilignes, verticales et
horizontales. L'ensemble est donc ordonné, comme le cosmos divin.
Mais certains éléments montrent le résultat de la course :
Hippodamie fait la gestuelle du mariage, la femme est inquiète ; un des philosophes,
celui qui regarde Oenomaos est pris par le doute. Les dès sont jetés.
b. Le fronton ouest
Il correspond à un autre épisode mythologique : la guerre entre les centaures
et les Lapithes.
Cette bataille a pour origine le mariage du roi des Lapithes, Peirithous – Pirithoos. Il invite ses
frères et par courtoisie les centaures (tête de cheval, corps d'homme). Seulement, les
centaures boivent plus qu'il ne convient, et il leur prend des envies : ils ont alors
projet d'enlever les femmes Lapithes ; la bataille s'engage.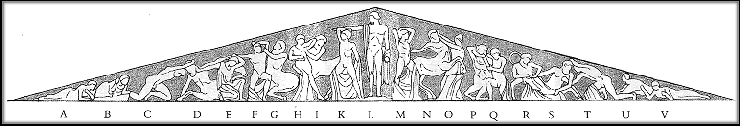
Sur le fronton Est, l'ordre régnait. Ici, c'est le mouvement qui domine
sauf en un endroit, au centre, en la personne du dieu Apollon. Pour le reste, peu de lignes horizontales ou verticales, seulement des
forces verticales.
Apollon combat aux côtés des Lapithes et là encore, on sait qui va gagner. Apollon tend son bras droit
au-dessus du roi des Lapithes, en signe de protection. D'autre part, le visage d'Apollon
est fermé, sculpturalement bien dessiné, comme les visages des Lapithes qui ressemblent
ainsi à des dieux ; en revanche, les centaures sont hirsutes, fronçant les sourcils ;
ils marquent des expressions. Leurs cheveux et barbes ne sont pas peignées (signe des
barbares).
C'est ici l'affrontement entre le cosmos divin qui se
réfléchit dans les mortels et notamment chez les Grecs, contre l'ordre barbare
représenté ici par les centaures.
L'ensemble ne peut être pris isolément : pourquoi le dieu
lèverait-il un bras ?
A un fronton rigide répond donc un fronton agité ; c'est une
particularité de la période sévère.
Ces oppositions, on les retrouve dans les métopes de Zeus.
4) Les métopes du temple de Zeus à Olympie
Héraklès est le
personnage légendaire à l'origine duquel sont initiés les jeux d'Olympie.
On retrouve le calme serein sur la métope du lion de Némée, celles des oiseaux du lac
Régille, des pommes des Aspérides ; on retrouve le mouvement et l'exubérance dans le
combat avec la reine des amazones, contre le monstre guerrion etc.. Parfois des mariages :
la capture des chevaux de Diomède ; Héraclès est serein, droit, cependant le mouvement
et la vitalité se trouvent dans le cheval cabré.
Les métopes nous apprennent aussi d'autres choses.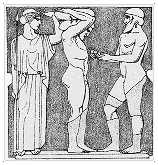 Le jardin des Hespérides.Au centre Heraklès qui soutient la voûte céleste, mais il courbe l'échine, a
besoin des deux bras et d'un coussin. Athéna, qui soutient également la voûte n'a
besoin que d'un bras. L'attitude d'Atlas aussi : il s'engage à chercher les pommes pour se libérer du
fardeau. Ce n'est que par ruse qu'Héraklès se libère dans la légende. Ors ici,
l'artiste montre autre chose : Atlas ramène ses pommes sans arrière pensée, tous les
sentiments humains effacés au profit des nobles.
Le jardin des Hespérides.Au centre Heraklès qui soutient la voûte céleste, mais il courbe l'échine, a
besoin des deux bras et d'un coussin. Athéna, qui soutient également la voûte n'a
besoin que d'un bras. L'attitude d'Atlas aussi : il s'engage à chercher les pommes pour se libérer du
fardeau. Ce n'est que par ruse qu'Héraklès se libère dans la légende. Ors ici,
l'artiste montre autre chose : Atlas ramène ses pommes sans arrière pensée, tous les
sentiments humains effacés au profit des nobles.
Le lion de Némée ; pour la première fois, on nous
montre le lion mort. Ici l'épisode est représenté après le combat. Héraclès est
imberbe, donc jeune. Mais le personnage est courbé, fatigué ; ce n'est pas l'Héraklès
invulnérable de l'époque archaïque : il montre ses faiblesses. On veut montrer que
l'homme à ses limites, qu'il souffre. Cette métope est donc très avant-gardiste.
5) Les artistes
Le plus célèbre est Myron. C'est un athénien qui a travaillé entre 450 et 440.
Seulement il est rare de pouvoir lier les sculptures aux sculpteurs. Pour Myron, on est
certains qu'il à sculpter le discobole.
L'original est perdu, mais il nous reste une copie
d'époque romaine. Découverte à Rome, la statue fait 1,55 de haut. On y retrouve la
froideur du style sévère. Cependant, on retrouve l'exubérance du mouvement, comme une
photographie précédant le lancer du disque.
Dans l'antiquité, ce n'était pas la plus célèbre sculpture de Myron ; la plus célèbre étant une vache en
bronze sur l'acropole d'Athènes.
Elle était tellement bien faite qu'on eut dit une vraie, disait-on !
6) Les objets
Des terres cuites de grandes qualités. Par exemple, l'enlèvement de Ganymède par Zeus. Elle fait plus d'un
mètre de haut. On retrouve le style sévère avec quelques restes archaïques (yeux, la
coiffure, le sourire du jeune enfant). Donc début Ve. Style sévère : mouvement, la
sereinité de l'enfant enlevé.
Ce style a paradoxalement duré peu de temps suivi
très vite du premier classicisme.
Texte établi à partir d'un cours de faculté
en 1998-9
Grands Mercis au professeur